You were a dick – Idaho, 2011
Si la magie, la vraie, pas celle qui se résume à quelques tours de passe-passe permis par une dextérité digitale qui relève de la simple virtuosité mécanique, si la magie donc, est une affaire de parole, si elle se définit comme l’art de nommer correctement les choses, alors parmi les multiples pouvoirs dont disposent les Etats-Unis d’Amérique, il en est un qui relève de la magie, et qui consiste à générer un univers à partir du seul nom de ses Etats.
Ainsi, si on voulait créer un groupe ou si on enregistrait un album et qu’on n’arrivait pas à lui trouver un nom, on pourrait prendre n’importe lequel des Etats fédérés d’Amérique du Nord, 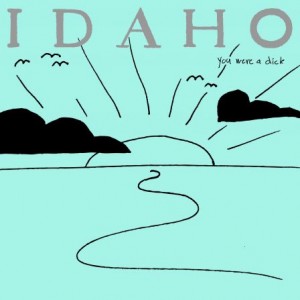 et le coller sur le disque, habillé d’une typographie en phase avec les architectures sonores qu’on a patiemment bâties. Immédiatement, un paysage mental précédera l’écoute, à un point tel que si la musique n’est pas suffisamment puissante, si son squellette est trop frêle, elle pourrait être engloutie dans ce nom ; c’est déjà arrivé. Le principe est tellement efficace qu’à vrai dire, il sera difficile de trouver un nom d’Etat qui n’ait pas été capté par telle ou telle formation musicale, certaines ayant même fait main basse sur les noms des villes qui, elles aussi, sont des mondes à part entière.
et le coller sur le disque, habillé d’une typographie en phase avec les architectures sonores qu’on a patiemment bâties. Immédiatement, un paysage mental précédera l’écoute, à un point tel que si la musique n’est pas suffisamment puissante, si son squellette est trop frêle, elle pourrait être engloutie dans ce nom ; c’est déjà arrivé. Le principe est tellement efficace qu’à vrai dire, il sera difficile de trouver un nom d’Etat qui n’ait pas été capté par telle ou telle formation musicale, certaines ayant même fait main basse sur les noms des villes qui, elles aussi, sont des mondes à part entière.
Quelques villes, sur d’autres territoires, ailleurs sur la surface de la planète, bénéficient elles aussi de ce privilège de connaître des jumelles abstraites, des entités déterritorialisées, des plans sans lieux. Mais les Etats-Unis demeurent, et de loin, le territoire qui est le plus habité de lieux qui sont aussi des non-lieux.
Ce n’est pas que les groupes ayant choisi pour se nommer tel ou tel lieu soient nécessairement incontournables. Loin de là. C’est plutôt que, si on met de côté quelques cas particuliers (en particulier les Etats dont le nom est composé), ces noms sont de tels concentrés d’images, de panoramas, de sensations, de mouvements, de travellings, d’impressions géographiques, météorologiques, telluriques, qu’ils amènent avec eux toute la puissance des territoires mythiques dont ils sont le signe. Autant dire que celui qui se choisit un tel étendard a intérêt à être à la hauteur de son drapeau et du mot qu’il utilise.
Pas étonnant que cette magie soit, en fait, très liée au cinéma ; car au-delà des sonorités des mots eux-mêmes, qui renvoient souvent aux peuples disparus qui peuplèrent jadis ces territoires, la puissance particulière de la géographie américaine tient au fait que nous y avons tous déjà voyagé par le plus efficace des moyens : l’œil délocalisé de la caméra de cinéma. Il n’est pas étonnant de voir les groupes qui se sont ainsi jumelés avec tel ou tel Etat américain automatiquement téléportés sur l’espace cinémascope des écrans mentaux. La musique est alors, qu’elle soit conçue comme telle ou pas, la bande son d’un film mental, de rêveries en translation sur les routes, d’Est en Ouest le plus souvent, par tous les moyens de locomotion connus, du Greyhound au chariot, de la Dodge Challenger à l’avion aspergeant en rase-motte des champs dénués de toute plantation. Lire « Nebraska » ou « Kansas » sur une pochette de disque, c’est avoir déjà la tête ailleurs.
Alors, même pour celui qui ne connaitrait pas la musique produite sous le nom « Idaho », le nom seul suffit à initier le voyage.
Ainsi, Idaho.
Si on voulait être factuel, on pourrait dire que derrière ce nom se trouve, désormais, un seul homme, Jeff Martin. Mais la magie a déjà opéré, et c’est un peu comme si on s’en foutait un peu, de qui est derrière, puisque revenir à l’individu dont « Idaho » est le pseudonyme, c’est se placer en deçà du nom, dans le petit secret de fabrication, alors que le mot, justement, aspire à l’altitude, à l’horizon dégagé, aux sommets enneigés. Jeff Martin semble lui-même avoir acté cette nécessité de se retrancher derrière un nom plus vaste. Il sort peu, peine à rencontrer du monde, enregistre seul, à la maison, ses disques, depuis que ses partenaires initiaux ont, peu à peu, quitté la formation, lui laissant les commandes du navire qu’il dirige en Capitaine Nemo.
L’Idaho n’est pas le genre de coin où d’amples mouvements de caméra sur des routes rectilignes seraient envisageables. Reliefs, sommets perçant les nuages. Ce n’est pas tant que les Rocheuses soient, ici, particulièrement élevées. C’est plutôt qu’elles sont amples. Comme si on avait pris les Alpes, et qu’on avait changé leur échelle de superficie, de manière à les élargir. Ainsi, malgré les escarpements, on voit loin et tout incite à se déplacer du regard depuis un point fixe.
La musique d’ Idaho, c’est exactement ça. Un mouvement qui pourrait devenir ample, mais qui s’ouvre sans l’amplitude, sans être absorbé par elle. Une contemplation respectueuse en somme, qui resterait en retrait de son objet, afin de ne pas l’épuiser. Chaque écoute donne l’impression que les morceaux sont trop courts, qu’ils n’ont pas été au bout de leur propre développement. Et pourtant, plus on écoute, et plus on réalise que c’est ainsi qu’ils sont accomplis. En suspension.
Empruntant à des styles divers, Jeff Martin est l’auteur d’une musique qui serait difficile à répertorier. On pense à Sufjan Stevens, Elliott Smith , mais aussi aux Smashing Pumkins, ; certaines introductions pourraient même laisser croire à une entrée en matière de Morcheeba. Mais jamais les morceaux ne suivent une direction dont on pourrait se dire qu’elle se  réfère à une catégorie particulière, et si les morceaux semblent épurés, ils apparaissent, au fur et à mesure des écoutes, bâtis de manière très complexe, enchevêtrements de détails discrets, ne se révélant que petit à petit, faisant de chacun d’entre eux un compagnon fidèle, jamais épuisé.
réfère à une catégorie particulière, et si les morceaux semblent épurés, ils apparaissent, au fur et à mesure des écoutes, bâtis de manière très complexe, enchevêtrements de détails discrets, ne se révélant que petit à petit, faisant de chacun d’entre eux un compagnon fidèle, jamais épuisé.
Pour des raisons qui me sont tellement intimes que je ne les connais même pas, l’écoute de « You were a dick » m’avait remis en mémoire la ballade larguée de Old Joy, le road movie de Kelly Reichardt. A l’écoute, bon nombre des morceaux, particulièrement ceux dans lesquels la fluidité du piano domine, me ramènent à ce moment magnifique, au-delà du temps, en plein forêt, dans cette immense refuge, au beau milieu des sources alimentant des baignoires creusées à même des troncs d’arbres. Une des chroniques qui ont accueilli l’album d’Idaho mentionnait « ce petit feedback lointain qui sonne comme une forme d’écho fugace, une réminiscence de tension urbaine et de stress contemporain, qui s’évanouit dans la nature et qui réapparait parfois de façon totalement spontanée. On entend ça depuis « Alas« , comme si l’énergie abrasive des guitares d’antan avait laissé la place à ce lointain feedback qui venait confronter ces mélodies introspectives à des souvenirs douloureux que l’on finit par accepter avec le temps, comme de vieux vêtements que l’on n’a plus honte de porter. » (http://www.indiepoprock.net/review.php?id=3665 quelques lignes ont cristallisé le lien que je tissais entre les montagnes de l’Idaho et les Bagby Hot springs de l’Etat voisin, l’Oregon. La tristesse n’est qu’une joie passée. Il est probable que les chansons de Jeff Martin puisent leur force, leur sérénité un peu nostalgique dans cette manière de regarder le bonheur comme ce pays d’où on n’est jamais vraiment parti, ce qui rend vaine toute tentative d’y retourner. Sans être calculée, l’ironie mélancolique qui suinte de la musique d’Idaho est sans doute touchante parce qu’elle imprime en nous, simultanément, cet élan vers ce qui n’est plus, et la retenue de ce mouvement.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YF4XhuiCrT4[/youtube]
Appendices :
Avouons le, on n’aurait pas vraiment pensé publier un article à propos de ce disque si un commentaire n’en avait pas soufflé l’idée, voire le défi. C’était d’autant moins dans nos intentions qu’on avait déjà lu la chronique de Bayon, dans Libé. Et va donc passer après Bayon… C’est d’ailleurs ce texte qui avait conduit cet album à s’infiltrer, via mon casque, dans mes oreilles et mon cerveau. Pour lire le texte de Bayon, c’est par ici : http://next.liberation.fr/culture/01012349718-une-certaine-idee-d-idaho (une chose rassure : le titre vraiment pas inspiré. Pour le reste, ça se confirme, écrire est un métier. Je n’ai encore rien publié ici à propos de Mezzanine, du même Bayon, mais c’est en partie parce que je ne sais pas comment restituer la déflagration de ses premières pages. Et il ne s’agit pas d’être heurté par un thème, mais d’être emporté par une écriture, suffisamment pour la suivre n’importe où.
Je rajouterai cet autre lien, lui même connecté à l’article de Bayon et signalant son existence dans les commentaires d’indiepoprock.net : http://www.magicrpm.com/a-lire/chronique/idaho/you-were-a-dick. Je ne me lasse pas de lire les chroniques de ces amateurs de musique bien plus calés que moi sur leur sujet, et bien plus fidèles, aussi, aux musiciens qu’il apprécient. Je suis peu l’actualité et découvre souvent que ceux que j’aimerais suivre ont poursuivi leur propre chemin sans que j’en sache rien.
On apprendra dans les liens cités ci-dessus qu’en fait, Idaho a bien failli s’appeler Iowa, ce qui, en matière de reliefs, aurait tout changé.
Et puis,, pour compléter la playlist des groupes et albums inspirés par les Etats américains, on rappelera que Sufjan Stevens est censé avoir pour projet de réaliser un album pour chaque Etat que comportent les USA. Michigan et Illinois ont déjà leur galette. Il a encore un peu de pain sur la planche et, à vrai dire, il n’est pas exclu que le Dacota du sud doive attendre encore quelque temps l’album qui lui serait dédié. La Californie peut, elle, compter sur les services de the American Music Club, qui lui a consacré un album, et le Nebraska a déjà été célébré par Bruce Springsteen, dans ce qui restera peut être, plus tard, comme son album le plus essentiel. Quant au Kansas, le groupe du même nom se charge de sa publicité, principalement grace à ce titre qui constitue, à lui seul, un long travelling le long d’une des consoeurs de la route 66 : Dust in the wind.
Enfin, puisqu’il a été question de Old Joy, je préciserai que pour ma part, lorsque je tente de partager, quelques instants, l’expérience physique d’être américain (il faudrait distinguer, ici, « américain » d' »Etats-unien »), lorsque je veux me poser sur un chariot de travelling pour un cruising à vitesse modérée, tout au couple, au long de ces terres qui sont parmi les rares epaces qui puissent encore s’appeler « Terres », je me tourne plutôt vers Will Oldham, sous son nom, sous le pseudonyme de Bonne ‘Prince’ Billy, ou dans la formation ‘Palace Brothers’. Portant sur ses épaules nonchalantes le rôle principal de Old Joy (qui n’est même plus un rôle, tant il apparait peu à peu qu’il n’aurait pu être attribué à personne d’autre), Oldham semble être l’incarnation, dans un corps étrangement fascinant et habité, d’un rapport à la terre tellement simple qu’il en devient mystérieux. Un jour, je ferai un article sur ces chanteurs à l’allure un peu négligée, mi hommes des bois, mi créatures mystiques; prophètes ruraux échappés des villes. Un jour, aussi, je ferai un article sur le pouvoir réinitiatique de la forêt, dont les racines remontent au moins jusqu’à Shakespeare, et dont les bourgeons donnent des fleurs, aujourd’hui, aussi bien chez Kelly Reichardt, chez Apichatpong Weerasethakul ou Alain Guiraudie.
Dans les toujours très tordus mots croisés du Canard enchaîné d’aujourd’hui, en cinq lettres : « Le gère Boise ».